Accueil > Témoignages > Du côté des professionnels > Dr Elisabeth Angellier (cancérologue) – Le temps du médecin en cancérologie : (...)
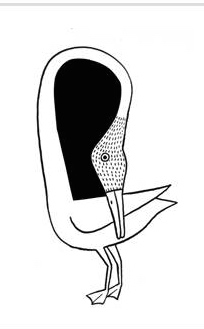
Dr Elisabeth Angellier (cancérologue) – Le temps du médecin en cancérologie : un choix personnel – Lettre n°6 – novembre 2004
Consacrer du temps à un malade, c’est le plus souvent répondre à une demande non formulée. Ce temps ne se compte pas seulement, ou pas toujours en minutes. Il se compterait plutôt en qualité de temps, en adéquation.
C’est plus une ouverture, une disponibilité, une réponse à l’attente de se voir reconnaître comme une personne et pas seulement comme le porteur d’une maladie.
Organiser son temps, c’est pour le médecin faire des choix qui l’engagent.
Avant une consultation je regarde le nombre de malades, leurs noms et le nombre de nouveaux. Si je vois que cela sera « trop », je fais décaler certains malades pour dégager du temps. Nous – une des secrétaires ou moi-même - leur expliquons les raisons de ces modifications, qui leur épargnent une longue attente…
Ce « trop », je le mesure à l’aune des anciennes consultations des personnes qui doivent venir, ou au stade de leur maladie (une rechute inattendue par exemple, et bien sûr l’annonce). Je le mesure aussi à mes propres capacités « d’encaissement ». Je sais qu’au-delà de trois voire quatre entretiens très difficiles, il me faudra un temps de récupération. Mes secrétaires le savent aussi, et elles organisent la consultation de telle sorte que soient alternés les « niveaux de difficulté ». Elles mettront par exemple une consultation de surveillance entre deux nouveaux. S’il y a une urgence (nouvelle prise en charge ou demande expresse d’une personne), elles lui proposeront un rendez-vous « hors consultation », rapidement, plutôt que de le rajouter en fin de consultation. Nous travaillons de la même façon pour les familles, et le plus possible sur rendez-vous, ce qui me permet aussi de me préparer.
L’équipe aussi a su s’adapter pour respecter le silence du bureau autant que possible.
Cela donne un planning très difficile à gérer, mais résolument tourné vers les malades.
Je sais que la répétition des consultations les plus lourdes ou des rendez-vous avec les familles peut conduire à une forme d’insensibilité. Pour garder ma « fraîcheur » d’écoute, sans impatience et sans faux-semblants, j’ai besoin d’une telle organisation. Elle me permet de vivre que chaque nouvelle personne qui entre soit comme la seule que je voie.
Ensuite, face à cette personne, j’essaie de « m’ouvrir » : être comme un réceptacle à ses questions, à son angoisse, à son besoin d’échapper à la tension aussi, en parlant parfois de choses et d’autres. De ces choses qui n’ont pas leur place dans un « interrogatoire médical » mais qui l’ont profondément dans une relation médecin-malade. Essayer de la connaître pour être au plus près de ses attentes.
Ce temps, sa qualité plus que sa durée, c’est aussi un peu de paix et de sincérité, dans l’univers chaotique de la maladie.
Quant à sa durée, elle est tributaire à la fois de la complexité des informations à délivrer et de la relation à instaurer.
A chaque nouvelle personne un nouveau rythme : il y a ceux qui au départ ont besoin d’un long temps, et ceux qu’il faudra revoir plusieurs fois, plus brièvement… C’est alors moi qui leur propose les rendez-vous ultérieurs. En général, ils ne le demandent pas, même s’ils n’ont rien entendu de la première consultation. Il y a ceux qui, au début, vont appeler plusieurs fois. Comme s’ils avaient besoin de vérifier ma parole, de vérifier ma disponibilité, avant de s’engager réellement. Vérifier sur quoi ils peuvent vraiment compter.
Iriez-vous poser des questions ou confier des inquiétudes à une personne qui vous regarde à peine, vous interrompt quand vous digressez de « l’interrogatoire médical », et vous promet de vous soigner sans prendre soin de vous ?
Le dialogue, la plainte, l’explosion émotionnelle n’auront pas lieu si j’ai l’air indifférente ou occupée. Je le sais. Tous les médecins le savent. Passer dans un couloir la mine affairée devant une famille qui attend des nouvelles, c’est refuser le dialogue. Quelques minutes suffiraient. Ce n’est pas une question de temps objectif, comptable, mais de choix intime. On peut passer trois quarts d’heure avec un malade sans l’entendre, et dix minutes en étant vraiment là, à son écoute. Ce refus d’entendre érige un rempart. Refuser les questions qui dérangent. Celles auxquelles nous ne saurons jamais répondre. Refuser l’expression de la souffrance.
Au fond, très peu de personnes se satisfont de la non-rencontre. Mais elles n’imaginent pas que le système de soins puisse leur offrir autre chose. Si elles s’en plaignent, c’est à l’extérieur, allant chercher parfois chez d’autres thérapeutes, dont ceux des médecines dites alternatives, l’écoute et l’attention que nous n’avons pas su leur donner. Et même lorsque nous leur accordons cette écoute et cette attention, même lorsqu’il y a rencontre, elles ne suffisent pas toujours : car dans la relation même qui s’établit, la difficulté est d’apprécier, pour chaque malade, son besoin d’aide, son besoin de parole notamment, auquel nous ne pouvons pas répondre et qui pourra justifier, le cas échéant, une adresse à un psychothérapeute.
« Les médecins n’ont pas le temps » est une rengaine souvent entendue du côté des médecins et une plainte souvent formulée par les patients. Donner du temps aux malades est avant tout un choix personnel. Il n’est pas sans risque tant il ferme bien des portes et ouvre à bien des difficultés, surtout dans le cadre hospitalier qui est le mien. Privilégier l’activité de soins, c’est renoncer à la course aux publications et au carriérisme, c’est renoncer à déléguer à d’autres ses responsabilités propres face au malade. C’est aussi savoir ne pas se perdre dans des tâches qui ne sont pas celles du médecin et qui, néanmoins, nous sont de plus en plus demandées par l’administration.
Donner du temps au malade, c’est parfois avoir à affronter l’hostilité de l’équipe soignante, au sens large de ce terme — hostilité ou agressivité d’une équipe qui peut se sentir abandonnée ou mise elle-même en défaut, et qui vous reproche alors d’entretenir des relations trop étroites ou trop exclusives avec les malades. Enfin, donner du temps au malade, c’est avant tout accepter la parole de l’autre et les effets qu’elle provoque en soi, ce qui est et doit rester l’un des aspects de l’exercice médical.
L’évaluation, à la mode aujourd’hui, permettra-t-elle de valoriser cet aspect de notre pratique ?
S’il est souhaitable que les dépenses soient contrôlées par l’administration qui finance le service public, il est souhaitable aussi que l’impunité et le silence ne soient plus la règle, à l’intérieur même du corps médical. Or cette évaluation-là dépend aussi de nous, et les médecins doivent s’engager dans l’évaluation de leurs propres pratiques. Quelle médecine voulons-nous exercer ? Il me semble que c’est la question posée à notre génération.
