Accueil > Témoignages > Du côté des professionnels > Marie Françoise Nédelec (psychanalyste) – Malade ou psychanalyste, (...)
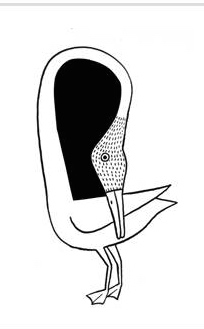
Marie Françoise Nédelec (psychanalyste) – Malade ou psychanalyste, psychanalyste et malade – lettre n°6 – novembre 2004
C’est par hasard que je suis tombée sur l’adresse de l’Association Psychisme et Cancer, en 2000. Par hasard, vraiment ?
Psychanalyste, j’avais pris en 1997 ma retraite des institutions où je travaillais depuis trente ans (hôpital de jour pour adolescents psychotiques et CMPP) et ne suivais plus que quelques patients en libéral. Fin 1998, mon mari était mort d’un cancer très invalidant après sept années pendant lesquelles j’avais été totalement absorbée par mon travail et l’accompagnement de ce malade profondément déprimé, qui était aussi le père de mes quatre enfants. Quelques mois plus tard apparut un vilain petit bouton sur la paupière. Après deux mois d’investigations, j’entendis en juillet le diagnostic : cancer de la moelle osseuse avec lymphomes. S’ensuivit une première chimio orale de six mois, puis une autre où je perdis mes cheveux, enfin une radiothérapie sur la paupière. En décembre 1999, ma mère mourut. Cette succession de traumas fit de moi, pendant toute l’année 2000, une survivante. Figée. Étais-je encore psychanalyste ?
Quand, en juillet 2001, je pris rendez-vous avec Françoise Bessis, c’est essentiellement en tant que malade, et poussée par la nécessité d’une approche psychanalytique centrée sur le trauma et le cancer. Elle me proposa d’intégrer son groupe après l’été — non sans m’avoir prise au dépourvu : souhaitais-je y tenir une place de psychanalyste ? Étant simplement venue la consulter, l’idée ne m’était pas venue à l’esprit. Mais j’avais l’été pour réfléchir. Malade ou psychanalyste ? À l’époque, pour moi, l’un excluait l’autre. Être psychanalyste et avouer que l’on avait un cancer me paraissait une position intenable. Elle m’a conseillé alors de lire Le livre de Pierre, de Louise L. Lambrichs. La façon dont Pierre Cazenave était parvenu à intégrer sa fonction de psychanalyste et sa condition d’être cancéreux m’a beaucoup intéressée et m’a permis, à mon retour en septembre, de me dire aussi psychanalyste.
D’emblée j’ai apprécié la convivialité, l’absence de hiérarchie, l’étayage psychique apporté par le groupe — à la fois par les accueillants et par la présence très active de la psychanalyste, sur laquelle j’avais fait un transfert. Mais étais-je vraiment psychanalyste ? à l’écoute de l’inconscient des autres ? Par moments sans doute, à mon insu, quand j’oubliais que j’étais malade. Mais je ne l’oubliais pas toujours et me sentais beaucoup trop intéressée par toutes les informations sur la maladie qu’apportaient les consultants. J’avais eu jusque-là des médecins peu loquaces et vivais très seule, en deuil. Sortant de ce repli je passais intérieurement d’une position à une autre, malade ou psychanalyste, sans, dirais-je, pouvoir être les deux. À cette difficulté intérieure s’ajoutait le fonctionnement particulier de notre permanence où nous étions deux psychanalystes. Déroutée par le fonctionnement souple de ce groupe où seuls les accueillants et les stagiaires sont des éléments permanents et nécessaires puisque les consultants ne sont pas toujours les mêmes d’une semaine à l’autre et que la psychanalyste est présente ou absente suivant qu’elle propose un entretien particulier, je ne me sentais psychanalyste, souvent, qu’en l’absence de l’autre. Et quand je quittais le groupe pour mener moi-même un entretien particulier, j’avais le sentiment au retour d’avoir manqué un épisode.
Ces entraves étaient perceptibles puisque à plusieurs reprises, je me suis aperçue que les nouveaux consultants ne m’identifiaient pas toujours comme analyste. Mais je ne me décourageai pas, prise par le travail que je pensais accomplir, à la fois sur moi et avec les autres — ce double travail constituant finalement un moteur pour le groupe.
En avril 2003, le cancer reprit et une troisième chimio, très dure, m’alita quasiment six mois. Contrainte de cesser toutes mes activités, je dus habiter chez mes enfants à tour de rôle. Pendant la première phase de ma maladie, je les avais sentis peu présents. La maladie de leur père, auquel je m’étais consacrée, les délaissant, puis ma maladie, qu’ils ont peut-être vécue dans ce temps de deuil comme un abandon supplémentaire, nous avaient séparés. Cette fois, grâce au travail accompli pendant deux ans au Centre, j’ai pu parler avec eux. Quelque chose entre nous s’est renoué. En septembre, j’ai retrouvé le groupe avec plaisir. Très fatiguée, certes, et avec une perruque, mais libérée de cette interrogation quant à cette double identité qui fonctionnait jusqu’à présent comme une exclusive. Devenue psychanalyste et malade, capable de me vivre comme telle, je retrouvai une énergie nouvelle, un nouveau désir de vivre et d’être analyste.
Ce qui fait lien entre les consultants de ce groupe est qu’ils souffrent pour la plupart, comme moi, d’atteintes narcissiques de la petite enfance. Histoires d’abandon, de désaveu, de blessures archaïques, ce sont toujours ces questions qui surgissent et autour desquelles nous travaillons. Pierre Cazenave fait l’hypothèse que cette fragilité psychosomatique prédispose au cancer. Ce qui d’emblée m’a semblé très clair, c’est que la possibilité de fantasmer sur les causes du cancer et l’origine de notre mal-être permettait d’intégrer notre cancer comme faisant partie de notre monde interne. Il n’est plus possible d’en faire seulement un accident de parcours et de l’expulser comme un mauvais objet, comme on a envie de rejeter ses imagos parentales négatives. Telle cette mère archaïque tour à tour bonne et mauvaise avec laquelle nous aurons à négocier notre vie durant, le cancer peut être assimilé à un mauvais objet interne avec lequel nous avons à composer. Sorti de la radicalité du primaire, penser sa maladie, l’introjecter, en faire un événement de son histoire, permet de vivre à nouveau, d’humaniser les traitements et les mutilations. Les malades doivent s’autoriser à régresser, à rêver, à retrouver les représentations oubliées ou refoulées, et même les sensations non inscrites, à lâcher prise sans lâcher tout. Ce travail autrement dit se situe à l’opposé de l’idée reçue actuelle selon laquelle il faudrait tirer un trait sur son cancer comme sur son passé, pour « positiver » envers et contre tout. Personne, me semble-t-il, ne mesure la violence contenue dans l’injonction, faite à un malade qui n’en a pas les moyens, d’avoir des pensées positives pour lutter.
Le groupe avec sa dynamique propre, qui s’invente à chaque permanence, apprend que la vie continue et permet d’aborder la peur de la mort et de la nommer. Comme analyste, je me sens garante que les choses peuvent se dire. Intégrer le réel du cancer, oser lâcher la bride à l’imaginaire qu’il déclenche et trouver les mots pour l’inscrire, tel est le travail de liaison que nous accomplissons. En quoi je me sens fidèle à ce que m’a appris Lacan sur le réel, l’imaginaire et le symbolique, dont le tissage garantit le sujet dans son être.
