Accueil > Témoignages > Du côté des professionnels > Claire Fournier (psychologue psychanalyste) – Psychanalyste en cancérologie – (...)
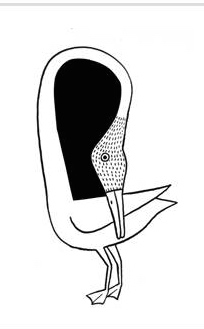
Claire Fournier (psychologue psychanalyste) – Psychanalyste en cancérologie – Lettre n°4 – novembre 2002
Quelle place donner à la vie psychique et aux soins qu’elle requiert dans un contexte hyper réaliste, celui de l’hôpital, où prime la technicité de plus en plus poussée des pratiques médicales ? Pour les psychanalystes travaillant en médecine, cette question se pose chaque jour.
En effet, s’ils sont de plus en plus présents et nombreux dans les champs médicaux, les psychanalystes n’y ont pas pour autant une place évidente ni confortable. Être psychanalyste à l’hôpital, en cancérologie, c’est être seul de son espèce au milieu des médicaux et paramédicaux, seul c’est-à-dire à côté, en marge. Marge qu’il convient de sauvegarder, contre vents et marées, contre toute tentative assimilante voire phagocytante du corps médical. Marge concernant tant notre statut au sein de l’institution hospitalière (il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet) que le rapport d’engagement intersubjectif qui nous lie à chaque patient en particulier et qui contraste singulièrement avec la transparence des dossiers médicaux transmissibles, eux, d’un médecin et d’un service à l’autre ; marge enfin quant à l’évaluation thérapeutique de cette science de l’âme, perçue comme « floue » par les tenants de l’objectivité scientifique et les plongeant souvent dans des abîmes de perplexité quand elle ne suscite pas leur mépris ou leur hostilité.
Mais être psychanalyste à l’hôpital, en cancérologie, c’est aussi être en marge par rapport au monde psychanalytique ayant refusé toute forme de compromis avec l’institution médicale. En effet, loin ici du schéma classique de la cure type, le psychanalyste va devoir non seulement élaborer et remanier constamment le cadre de la cure, mais supporter le poids majeur de la pathologie somatique, évaluer sa place dans la demande de suivi psychothérapeutique ou psychanalytique, et mettre à sa juste place la réalité scientifique, médicale, pour qu’elle ne vienne pas faire obstacle à l’élaboration psychique du patient, au déploiement de sa vie fantasmatique. Ainsi, beaucoup plus qu’ailleurs, le suivi de ces patients nous amène à naviguer entre ces deux réalités, comme les patients le font eux-mêmes. Je pense à Pénélope qui, peu de temps avant de mourir, évoque en l’espace de dix minutes les préparatifs de ses funérailles et s’inquiète de l’accueil que lui réserveront ses collègues lorsqu’elle retournera travailler. Plus que partout ailleurs il me semble, vie et mort ici s’enchevêtrent.
L’éventail des demandes, en cancérologie, est extrêmement large : suggérées parfois par les médecins ou les infirmières, elles sont entendues diversement par les malades, suscitant tantôt un sentiment d’abandon, tantôt un élan de confiance en une véritable alliance thérapeutique ; mais parfois aussi elles émanent du patient lui-même, allant alors du besoin de réconfort ponctuel à une réelle demande de travail psychique. Dans ce contexte pourtant, elles ont toutes en commun d’avoir, à l’origine, le cancer. Faisant irruption dans la continuité psychique du sujet et menaçant sa vie tant physique que psychique, la blessure du corps pousse ainsi à venir dire et écouter une tout autre blessure. Cette situation particulière pose à l’analyste de nombreuses questions : comment éviter d’être captif de ce réel du corps sans toutefois l’ignorer (ce qui serait pour le patient d’une violence insupportable) ? Comment répondre à son urgence de façon adéquate, différente des réponses médicales qui sont, le plus souvent, des réponses en actes ? Comment ne pas tomber dans la fascination du traumatisme et de l’horreur, et ainsi résister à toute sidération de la pensée dans laquelle le patient, dans un mouvement projectif, peut nous entraîner ? Comment aussi ne pas se laisser séduire par l’extrême rapidité d’élaboration que l’on rencontre parfois et qui rompt de façon spectaculaire avec le rythme « tranquille » des patients névrosés ?
Être analyste à l’hôpital ne signifie pas mener des cures classiques, mais travailler avec le référent analytique, dépister et suivre ce que l’on perçoit des mouvements inconscients de nos patients et de nous-même en maintenant notre travail autour de l’analyse du transfert et du contre-transfert. C’est aussi créer un cadre dont la maladie est l’une des coordonnées, en relation avec les soignants et le service hospitalier qui revêt une fonction maternelle et maternante et constitue en même temps un espace de jeu. C’est encore tisser et maintenir du lien psychique dans un cadre incongru qui donne parfois l’impression de nous malmener. Comment, en effet, analyser dans le transfert des séances annulées pour cause d’effets secondaires de la chimiothérapie ? Comment entendre des émergences dépressives majeures indissociables d’une période d’aplasie ? Comment, quand la santé s’améliore, inventer un cadre différent qui se rapprocherait plus du cadre analytique classique ? Comment alors imaginer que ce cadre pourrait se déprendre du médical ? Comment maintenir une permanence du lien thérapeutique au-delà des traitements et du suivi médical en évitant l’écueil d’une trop grande séduction ?
Parler du travail analytique en cancérologie, c’est parler de la place de la maladie dans l’économie psychique du patient, de l’érotisation de ce corps souffrant, de l’investissement libidinal de l’espace hospitalier, du service, des soignants comme autant d’objets partiels. C’est évoquer tout le cheminement nécessaire pour permettre une relibidinisation objectale.
Il faut pour cela accompagner le patient dans l’aventure sinueuse de son histoire, lui laisser la possibilité d’inventer peu à peu le roman de sa maladie, comme l’enfant son roman familial ou ses théories sexuelles. La question de l’origine ou du sens du cancer tient souvent le devant de la scène dans le premier temps des rencontres.
Toutefois, l’expérience montre que bien souvent, les patients se déprennent assez vite de cette question. D’autres champs s’ouvrent alors à eux.
Et la question fondamentale devient : « Comment, quelle que soit la suite ou l’issue de la maladie, puis-je être le sujet de mon histoire ? »
